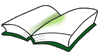| Titre : |
Approche contemporaine d'une affirmation de Dieu : Essai sur le fondement ultime de l'acte scientifique |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Jean-Dominique Robert (1910-...), Auteur ; Dominique Dubarle (1907-1987), Préfacier, etc. |
| Editeur : |
Paris : Desclée de Brouwer |
| Année de publication : |
1962 |
| Collection : |
Museum Lessianum section philosophique num. 50 |
| Importance : |
1 vol. (250 p.) |
| Format : |
23 cm |
| Langues : |
Français (fre) |
| Résumé : |
Seule valeur œcuménique aujourd'hui, la science peut-elle fournir à l'esprit humain un point de départ efficace vers Dieu? Telle est la question que pose le P. Robert, et il montre tout d'abord qu'une réflexion d'ordre épistémologique et métaphysique s’exerçant sur la science - pour en justifier les démarches et les présupposés essentiels - peut conduire progressivement un esprit scientifique jusqu'à l'Esprit divin.
Une longue enquête laisse apparaître que le labeur scientifique se reconnaît lié par des "nécessités intelligibles" assurant sa cohérence interne et sa continuité et qu'il attribue aux vérités couronnant son effort une valeur qu'aucun savant ne saurait revendiquer pour son bien exclusif, autrement dit, une valeur s'imposant à tous. Or les attributs essentiels de la vérité scientifique, c'est-à-dire son unité et sa nécessité, réclament un fondement qui ne peut être trouvé dans la multiplicité des esprits contingents qui construisent la science. Il faut donc en arriver à poser un garant ultime et absolu des attributs en question, c'est-à-dire un Dieu de vérité.
Comment nier l'intérêt et la nouveauté d'une telle argumentation? Elle est actuelle puisque son point de départ n'est autre que la science et la philosophie des sciences aujourd'hui en honneur, elle est de type existentiel puisqu'elle repose sur l'analyse réflexive des implications de l'acte même qui engendre nos vérités scientifiques. Enfin, elle est de nature "intrinséciste" et, par là même, échappe radicalement aux objections faites, à tort ou à raison, aux preuves fondées sur le mouvement ou la finalité inhérentes au monde matériel.
C'est de l'intérieur même des perspectives qu'elle se donne que l'auteur s'efforce de manifester les embarras auxquels se heurte toute interprétation idéaliste de l'acte scientifique. Il le fait plus spécialement à la lumière de deux cas contemporains particulièrement révélateurs: celui de Brunschvicg et celui de Husserl. Il n'est pas jusqu'à certaines positions l'existentialisme
(Merleau-Ponty, Sartre) qu'il ne considère.
Cette étude parvient ainsi à équilibrer, sans les détruire l'un par l'autre, le souci du dialogue et les droits de la vérité.
|
Approche contemporaine d'une affirmation de Dieu : Essai sur le fondement ultime de l'acte scientifique [texte imprimé] / Jean-Dominique Robert (1910-...), Auteur ; Dominique Dubarle (1907-1987), Préfacier, etc. . - Paris : Desclée de Brouwer, 1962 . - 1 vol. (250 p.) ; 23 cm. - ( Museum Lessianum section philosophique; 50) . Langues : Français ( fre)
| Résumé : |
Seule valeur œcuménique aujourd'hui, la science peut-elle fournir à l'esprit humain un point de départ efficace vers Dieu? Telle est la question que pose le P. Robert, et il montre tout d'abord qu'une réflexion d'ordre épistémologique et métaphysique s’exerçant sur la science - pour en justifier les démarches et les présupposés essentiels - peut conduire progressivement un esprit scientifique jusqu'à l'Esprit divin.
Une longue enquête laisse apparaître que le labeur scientifique se reconnaît lié par des "nécessités intelligibles" assurant sa cohérence interne et sa continuité et qu'il attribue aux vérités couronnant son effort une valeur qu'aucun savant ne saurait revendiquer pour son bien exclusif, autrement dit, une valeur s'imposant à tous. Or les attributs essentiels de la vérité scientifique, c'est-à-dire son unité et sa nécessité, réclament un fondement qui ne peut être trouvé dans la multiplicité des esprits contingents qui construisent la science. Il faut donc en arriver à poser un garant ultime et absolu des attributs en question, c'est-à-dire un Dieu de vérité.
Comment nier l'intérêt et la nouveauté d'une telle argumentation? Elle est actuelle puisque son point de départ n'est autre que la science et la philosophie des sciences aujourd'hui en honneur, elle est de type existentiel puisqu'elle repose sur l'analyse réflexive des implications de l'acte même qui engendre nos vérités scientifiques. Enfin, elle est de nature "intrinséciste" et, par là même, échappe radicalement aux objections faites, à tort ou à raison, aux preuves fondées sur le mouvement ou la finalité inhérentes au monde matériel.
C'est de l'intérieur même des perspectives qu'elle se donne que l'auteur s'efforce de manifester les embarras auxquels se heurte toute interprétation idéaliste de l'acte scientifique. Il le fait plus spécialement à la lumière de deux cas contemporains particulièrement révélateurs: celui de Brunschvicg et celui de Husserl. Il n'est pas jusqu'à certaines positions l'existentialisme
(Merleau-Ponty, Sartre) qu'il ne considère.
Cette étude parvient ainsi à équilibrer, sans les détruire l'un par l'autre, le souci du dialogue et les droits de la vérité.
|
|  |


 Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externesLes cieux peuvent-ils encore aujourd'hui "chanter la gloire de Dieu" / Jean-Dominique Robert in Nouvelle revue théologique, 99 n°6 (Novembre-Decembre 1977)
L'hominisation d'après René Girard / Jean-Dominique Robert in Nouvelle revue théologique, 100 n°6 (Novembre-Decembre 1978)
Modernisme et philosophie / Jean-Dominique Robert in Nouvelle revue théologique, 103 n°2 (Mars-Avril 1981)
Nécessité actuelle d'une démystification du scientifique / Jean-Dominique Robert in Nouvelle revue théologique, 97 n°5 (Mai 1975)
A propos de l'actuel retour de techniques psychosomatiques en vue d'une oraison contemplative chrétienne / Jean-Dominique Robert in Nouvelle revue théologique, 101 n°4 (Juin - Août 1979)
Les sciences humaines / Jean-Dominique Robert in Nouvelle revue théologique, 96 n°10 (Decembre 1974)