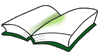| Titre : |
L'impasse industrielle |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Ingmar Granstedt (1946-....), Auteur |
| Editeur : |
Paris : Éditions du Seuil |
| Année de publication : |
1980 |
| Collection : |
01 Techno-critique, ISSN 0337-8020 |
| Importance : |
1 vol. (248 p.) |
| Présentation : |
couv. ill. en coul. |
| Format : |
21 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-02-005610-6 |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Cycle économique crise financière Technologie Organisation industrielle |
| Résumé : |
La prospective est à la mode; ses techniques se renouvellent et si la méthode des scénarios permet d'introduire dans l'exploration du futur des alternatives, dans d'autres domaines son volontarisme s'accentue. Il en est ainsi pour I. Granstedt qui, en publiant U impasse industrielle, examine les voies alternatives qui peuvent s'offrir, dans le domaine technologique, aux sociétés industrielles modernes, étudiant avant de faire des suggestions, les impasses auxquelles nous ont conduits les choix qui ont été antérieurement faits. Retrouvant en effet des distinctions naguère proposées par I. Illich et par J.-P. Dupuy, Granstedt considère que, pour produire des valeurs d'usage, existent deux types d'outils : les uns qualifiés d'autonomes, parce que les individus peuvent s'en servir personnellement, les autres dits intégrés parce qu'ils ne peuvent être employés que dans un système global cohérent. La structure des outils — même si elle n'est pas seule à intervenir puisque culture et rapports de pouvoir jouent aussi — conditionne pour partie les relations de production; cette structure est aujourd'hui « non seulement déterminante, mais socialement la plus dangereuse » (p. 18). Si les deux types d'outils sont tout à la fois complémentaires et rivaux, un choix existe en matière de technologies (qu'évoquent des expressions comme technologies douces, alternatives, appropriées, intermédiaires), choix d'autant plus indispensable que la puissance, si elle est souvent gage d'efficacité n'est pas nécessairement l'efficience (ou rapport entre efforts fournis et utilités retirées sous forme de valeurs d'usage (P- 155)- Le privilège accordé aux outils intégrés est à l'origine de la crise, analysée sous cinq aspects en autant de chapitres successifs. Rigidité et fragilité les caractérisant, les systèmes techniques contemporains sont tels que les délais qu'implique leur adaptation sont plus longs que leurs délais de gestation, tandis qu'on assiste au contraire à une accélération des événements perturbateurs et à leur généralisation à l'ensemble du système. Reposant sur une programmation stricte ils se caractérisent par leur complexité, leur lourdeur, leur absence de souplesse en raison des nombreuses interdépendances technico-organisationnelles, souvent de dimension transnationale, et des synchronisations étroites qui en découlent. Ces interconnexions peuvent être directes comme c'est le cas avec des complexes ou combinats industriels, elles peuvent résulter du système de transports qui assure un simple rôle de convoyeur, découler de la constitution de filières par les « ensembles marchandises » qui caractérisent souvent le commerce internalise des firmes multinationales, être le fruit de procédures institutionnelles qui prennent la forme de programmes, être relayées par l'informatisation. La fragilité accrue résulte de la convergence de nombreuses variables qui affectent un système, de la sensibilisation aux variables spécifiques d'un autre système qui entrent ainsi en synergie pour faire surgir de véritables variables de complication (p. 1 14). Lorsque l'auteur en vient à écrire que « l'intégration techno-organisationnelle conduit à la paralysie des réactions économiques », il suffit de songer à la panne d'EDF qui, un hiver, immobilisa l'ensemble de la France. A la différence des systèmes autonomes, les systèmes intégrés ont des exigences informationnelles accrues, portant sur un contexte élargi, informations dont la synthèse est de plus en plus malaisée à réaliser malgré la multiplication des centres de collecte; la distance s'accroît entre ce dont on devrait tenir compte et ce dont on prend effectivement connaissance : « pléthore et carence, saturation et ignorance chronique vont de pair » (p. 128); en conséquence la décision économique est bien souvent aveugle. Les problèmes se multipliant, les connaissances requises pour les maîtriser croissent en même proportion, Dans les systèmes intégrés la collaboration de nombreux spécialistes est nécessaire, posant un problème de décodage des informations en raison des langages spécialisés dont chacun dispose et de programmation des différentes interventions que tentent de résoudre par exemple, par des modalités différentes, les bureaux de méthodes ou les modèles de simulation. Les systèmes techniques intégrés requièrent des capitaux abondants dont la dimension sociale de l'assiette de collecte s'élargit : on peut ainsi estimer que, pour l'économie française, le coût moyen d'un seul projet représente deux ans d'épargne de 1 210 personnes actives (p. 176). Ces systèmes intégrés engendrent des forces — que l'on songe par exemple à l'atome — dont l'usage n'est pas sans danger, qu'il s'agisse de risques proprement techniques mais aussi de risques sociaux ou écologiques. D'où la prolifération de la législation pour y faire face, mais « ces mesures législatives ou réglementaires destinées à contrôler les risques deviennent progressivement des instruments pour gérer le comportement des acteurs socio-économiques » (p. 204). On comprend ainsi la signification du titre choisi par l'auteur : L'impasse industrielle vient de ce que « intégrés jusqu'à la démesure, de cinq manières simultanées, techno-organisationnelle, informationnelle, par les compétences, l'assiette des capitaux et la législation, les acteurs économiques ne peuvent agir que de manière chaotique » (p. 227). Au contraire, parce qu'ils sont de taille réduite, donc de financement relativement aisé, de spécificité limitée, pouvant faire l'objet de complémentarités souples, à risques aisément contrôlés, les outils autonomes représentent trois formes de liberté : l'agencement des opérations est le fait des individus immédiatement concernés, les procédés laissent une latitude appréciable d'exécution, la coordination temporelle reste circonscrite à quelques personnes. Cette indétermination relative permet, à l'échelle sociale, de disposer de filières de production mobiles et courtes, d'avoir des rythmes de production dont les fluctuations sont indépendantes les unes des autres, de rechercher des styles variés, de s'adapter aisément aux événements aléatoires. Fortement argumenté, illustré de manière abondante par des exemples empruntés aux différents domaines de la technologie contemporaine, l'ouvrage de Granstedt, s'il n'emporte pas nécessairement la conviction du lecteur (par exemple on peut estimer qu'au moins à moyen terme, malgré les dangers qu'elle présente, l'option nucléaire est en matière énergétique inévitable), oblige néanmoins à réfléchir. D'autant plus qu'il ne propose pas brutalement et simplement une autre alternative, mais suggère de « tracer une frontière entre les deux modes de production, discerner peu à peu les valeurs d'usage auxquelles le mode intégré est vraiment indispensable, déterminer le domaine d'activités auquel il sera confiné. Cela revient à définir un nouvel équilibre technologique » (p. 231). |
L'impasse industrielle [texte imprimé] / Ingmar Granstedt (1946-....), Auteur . - Paris : Éditions du Seuil, 1980 . - 1 vol. (248 p.) : couv. ill. en coul. ; 21 cm. - ( 01 Techno-critique, ISSN 0337-8020) . ISBN : 978-2-02-005610-6 Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
Cycle économique crise financière Technologie Organisation industrielle |
| Résumé : |
La prospective est à la mode; ses techniques se renouvellent et si la méthode des scénarios permet d'introduire dans l'exploration du futur des alternatives, dans d'autres domaines son volontarisme s'accentue. Il en est ainsi pour I. Granstedt qui, en publiant U impasse industrielle, examine les voies alternatives qui peuvent s'offrir, dans le domaine technologique, aux sociétés industrielles modernes, étudiant avant de faire des suggestions, les impasses auxquelles nous ont conduits les choix qui ont été antérieurement faits. Retrouvant en effet des distinctions naguère proposées par I. Illich et par J.-P. Dupuy, Granstedt considère que, pour produire des valeurs d'usage, existent deux types d'outils : les uns qualifiés d'autonomes, parce que les individus peuvent s'en servir personnellement, les autres dits intégrés parce qu'ils ne peuvent être employés que dans un système global cohérent. La structure des outils — même si elle n'est pas seule à intervenir puisque culture et rapports de pouvoir jouent aussi — conditionne pour partie les relations de production; cette structure est aujourd'hui « non seulement déterminante, mais socialement la plus dangereuse » (p. 18). Si les deux types d'outils sont tout à la fois complémentaires et rivaux, un choix existe en matière de technologies (qu'évoquent des expressions comme technologies douces, alternatives, appropriées, intermédiaires), choix d'autant plus indispensable que la puissance, si elle est souvent gage d'efficacité n'est pas nécessairement l'efficience (ou rapport entre efforts fournis et utilités retirées sous forme de valeurs d'usage (P- 155)- Le privilège accordé aux outils intégrés est à l'origine de la crise, analysée sous cinq aspects en autant de chapitres successifs. Rigidité et fragilité les caractérisant, les systèmes techniques contemporains sont tels que les délais qu'implique leur adaptation sont plus longs que leurs délais de gestation, tandis qu'on assiste au contraire à une accélération des événements perturbateurs et à leur généralisation à l'ensemble du système. Reposant sur une programmation stricte ils se caractérisent par leur complexité, leur lourdeur, leur absence de souplesse en raison des nombreuses interdépendances technico-organisationnelles, souvent de dimension transnationale, et des synchronisations étroites qui en découlent. Ces interconnexions peuvent être directes comme c'est le cas avec des complexes ou combinats industriels, elles peuvent résulter du système de transports qui assure un simple rôle de convoyeur, découler de la constitution de filières par les « ensembles marchandises » qui caractérisent souvent le commerce internalise des firmes multinationales, être le fruit de procédures institutionnelles qui prennent la forme de programmes, être relayées par l'informatisation. La fragilité accrue résulte de la convergence de nombreuses variables qui affectent un système, de la sensibilisation aux variables spécifiques d'un autre système qui entrent ainsi en synergie pour faire surgir de véritables variables de complication (p. 1 14). Lorsque l'auteur en vient à écrire que « l'intégration techno-organisationnelle conduit à la paralysie des réactions économiques », il suffit de songer à la panne d'EDF qui, un hiver, immobilisa l'ensemble de la France. A la différence des systèmes autonomes, les systèmes intégrés ont des exigences informationnelles accrues, portant sur un contexte élargi, informations dont la synthèse est de plus en plus malaisée à réaliser malgré la multiplication des centres de collecte; la distance s'accroît entre ce dont on devrait tenir compte et ce dont on prend effectivement connaissance : « pléthore et carence, saturation et ignorance chronique vont de pair » (p. 128); en conséquence la décision économique est bien souvent aveugle. Les problèmes se multipliant, les connaissances requises pour les maîtriser croissent en même proportion, Dans les systèmes intégrés la collaboration de nombreux spécialistes est nécessaire, posant un problème de décodage des informations en raison des langages spécialisés dont chacun dispose et de programmation des différentes interventions que tentent de résoudre par exemple, par des modalités différentes, les bureaux de méthodes ou les modèles de simulation. Les systèmes techniques intégrés requièrent des capitaux abondants dont la dimension sociale de l'assiette de collecte s'élargit : on peut ainsi estimer que, pour l'économie française, le coût moyen d'un seul projet représente deux ans d'épargne de 1 210 personnes actives (p. 176). Ces systèmes intégrés engendrent des forces — que l'on songe par exemple à l'atome — dont l'usage n'est pas sans danger, qu'il s'agisse de risques proprement techniques mais aussi de risques sociaux ou écologiques. D'où la prolifération de la législation pour y faire face, mais « ces mesures législatives ou réglementaires destinées à contrôler les risques deviennent progressivement des instruments pour gérer le comportement des acteurs socio-économiques » (p. 204). On comprend ainsi la signification du titre choisi par l'auteur : L'impasse industrielle vient de ce que « intégrés jusqu'à la démesure, de cinq manières simultanées, techno-organisationnelle, informationnelle, par les compétences, l'assiette des capitaux et la législation, les acteurs économiques ne peuvent agir que de manière chaotique » (p. 227). Au contraire, parce qu'ils sont de taille réduite, donc de financement relativement aisé, de spécificité limitée, pouvant faire l'objet de complémentarités souples, à risques aisément contrôlés, les outils autonomes représentent trois formes de liberté : l'agencement des opérations est le fait des individus immédiatement concernés, les procédés laissent une latitude appréciable d'exécution, la coordination temporelle reste circonscrite à quelques personnes. Cette indétermination relative permet, à l'échelle sociale, de disposer de filières de production mobiles et courtes, d'avoir des rythmes de production dont les fluctuations sont indépendantes les unes des autres, de rechercher des styles variés, de s'adapter aisément aux événements aléatoires. Fortement argumenté, illustré de manière abondante par des exemples empruntés aux différents domaines de la technologie contemporaine, l'ouvrage de Granstedt, s'il n'emporte pas nécessairement la conviction du lecteur (par exemple on peut estimer qu'au moins à moyen terme, malgré les dangers qu'elle présente, l'option nucléaire est en matière énergétique inévitable), oblige néanmoins à réfléchir. D'autant plus qu'il ne propose pas brutalement et simplement une autre alternative, mais suggère de « tracer une frontière entre les deux modes de production, discerner peu à peu les valeurs d'usage auxquelles le mode intégré est vraiment indispensable, déterminer le domaine d'activités auquel il sera confiné. Cela revient à définir un nouvel équilibre technologique » (p. 231). |
|  |


 Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes