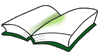[n° ou bulletin]
| Titre : |
N°160 - Juin 2012 - Les anonymes de l’Évangile |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Vianney Bouyer, Auteur |
| Année de publication : |
2025 |
| Importance : |
1 vol. (71 p.) |
| Format : |
19 cm |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Bible. N.T.. Évangiles synoptiques -- Analyse du discours narratif
Bible. N.T.. Évangiles synoptiques -- Critique et exégèse
Christologie,
Enfants -- Dans la Bible
Parenté dans la Bible
Jésus -- NT synoptiques
Luc 21, 1-4
Marc 12, 37 - 13, 1 |
| Résumé : |
On les appelle personnages « secondaires », « mineurs », « marginalisés ». Ils pullulent dans les récits évangéliques. Dans la littérature, classique ou biblique, leur fonction est souvent de participer « à l’action menée par le personnage principal ou à la transformation de celui-ci » ou encore de « dramatiser l’état intérieur du héros » (Jean-Louis Ska, « “Nos pères nous ont raconté”. Analyse des récits de l’Ancien Testament », C.E. n° 155 (2011), p. 84-87). Dans les « vies de Jésus » que sont les évangiles, il y a plus.
Ils ont parfois un nom (Bartimée, Jaïre…) mais, le plus souvent, ils demeurent anonymes. Serait-ce que la plupart sont marginalisés – en particulier les femmes – dans la société du 1er siècle, juive, grecque ou romaine ? Or, l’on remarque que Bartimée n’a de nom que chez Marc, et que Matthieu définit Jaïre par le seul qualificatif de « notable ». Pourquoi cet effacement ? Serait-ce pour mettre en valeur le trait qui leur est commun à tous, ce trait capital qui est donné à revivre au lecteur : la rencontre de Jésus ?
Ils sont venus à lui ou bien Jésus est allé vers eux. La rencontre a été unique (au contraire des disciples, on ne les revoit plus) et quelque chose d’unique est advenu pour eux ou leurs proches : guérison du corps, pardon des péchés, réintégration familiale ou sociale. Dans cet événement, il y a la perception souvent fugitive, parfois incomplète, du mystère de Jésus, « Fils de Dieu », « Messie » d’Israël, « lumière des nations »… Les guérisons d’aveugles, par exemple, ne sont alors pas secondaires et les narrateurs le soulignent en attirant l’attention sur les réactions de Jean le Baptiste ou des apôtres, à commencer par Pierre, Jacques et Jean.
C’est le mérite du Dossier rédigé par Vianney Bouyer d’inviter à relire nombre d’épisodes évangéliques en montrant l’importance majeure de personnages mineurs pour comprendre la mission de Jésus et la condition de disciple. L’inachèvement des histoires est alors remis au lecteur, puisque l’Évangile s’écrit encore aujourd’hui.
La partie Actualités revient sur la conclusion du Congrès 2011 des biblistes de l’ACFEB (Association catholique française pour l’étude de la Bible). Le thème du Congrès était intrigant : « Entre théologiens et exégètes, la Bible… » La Bible comme un objet posé entre ces deux catégories de lecteurs ? La réflexion, plus œcuménique que jamais, ne s’est pas contentée de théorie mais s’est affrontée à des pratiques sur des thèmes (création, rétribution) et des domaines de recherche (la morale, la culture). La citation finale de J. Zumstein rejaillit d’ailleurs sur la problématique du Dossier qui apparaît bien comme œuvre d’exégèse et de théologie pastorale : « [L’exégèse] est la médiation qui permet à l’Église d’avoir accès à sa mémoire créative et libératrice. » |
[n° ou bulletin]
N°160 - Juin 2012 - Les anonymes de l’Évangile [texte imprimé] / Vianney Bouyer, Auteur . - 2025 . - 1 vol. (71 p.) ; 19 cm. Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
Bible. N.T.. Évangiles synoptiques -- Analyse du discours narratif
Bible. N.T.. Évangiles synoptiques -- Critique et exégèse
Christologie,
Enfants -- Dans la Bible
Parenté dans la Bible
Jésus -- NT synoptiques
Luc 21, 1-4
Marc 12, 37 - 13, 1 |
| Résumé : |
On les appelle personnages « secondaires », « mineurs », « marginalisés ». Ils pullulent dans les récits évangéliques. Dans la littérature, classique ou biblique, leur fonction est souvent de participer « à l’action menée par le personnage principal ou à la transformation de celui-ci » ou encore de « dramatiser l’état intérieur du héros » (Jean-Louis Ska, « “Nos pères nous ont raconté”. Analyse des récits de l’Ancien Testament », C.E. n° 155 (2011), p. 84-87). Dans les « vies de Jésus » que sont les évangiles, il y a plus.
Ils ont parfois un nom (Bartimée, Jaïre…) mais, le plus souvent, ils demeurent anonymes. Serait-ce que la plupart sont marginalisés – en particulier les femmes – dans la société du 1er siècle, juive, grecque ou romaine ? Or, l’on remarque que Bartimée n’a de nom que chez Marc, et que Matthieu définit Jaïre par le seul qualificatif de « notable ». Pourquoi cet effacement ? Serait-ce pour mettre en valeur le trait qui leur est commun à tous, ce trait capital qui est donné à revivre au lecteur : la rencontre de Jésus ?
Ils sont venus à lui ou bien Jésus est allé vers eux. La rencontre a été unique (au contraire des disciples, on ne les revoit plus) et quelque chose d’unique est advenu pour eux ou leurs proches : guérison du corps, pardon des péchés, réintégration familiale ou sociale. Dans cet événement, il y a la perception souvent fugitive, parfois incomplète, du mystère de Jésus, « Fils de Dieu », « Messie » d’Israël, « lumière des nations »… Les guérisons d’aveugles, par exemple, ne sont alors pas secondaires et les narrateurs le soulignent en attirant l’attention sur les réactions de Jean le Baptiste ou des apôtres, à commencer par Pierre, Jacques et Jean.
C’est le mérite du Dossier rédigé par Vianney Bouyer d’inviter à relire nombre d’épisodes évangéliques en montrant l’importance majeure de personnages mineurs pour comprendre la mission de Jésus et la condition de disciple. L’inachèvement des histoires est alors remis au lecteur, puisque l’Évangile s’écrit encore aujourd’hui.
La partie Actualités revient sur la conclusion du Congrès 2011 des biblistes de l’ACFEB (Association catholique française pour l’étude de la Bible). Le thème du Congrès était intrigant : « Entre théologiens et exégètes, la Bible… » La Bible comme un objet posé entre ces deux catégories de lecteurs ? La réflexion, plus œcuménique que jamais, ne s’est pas contentée de théorie mais s’est affrontée à des pratiques sur des thèmes (création, rétribution) et des domaines de recherche (la morale, la culture). La citation finale de J. Zumstein rejaillit d’ailleurs sur la problématique du Dossier qui apparaît bien comme œuvre d’exégèse et de théologie pastorale : « [L’exégèse] est la médiation qui permet à l’Église d’avoir accès à sa mémoire créative et libératrice. » |
|  |

 Ajouter le résultat dans votre panier
Ajouter le résultat dans votre panierLes anonymes des 'évangiles in Cahiers Evangile, N°160 (Juin 2012)
Une veuve dans le Temple in Cahiers Evangile, N°160 (Juin 2012)
Rencontre avec des souffrants in Cahiers Evangile, N°160 (Juin 2012)
Des parents à la rencontre de Jésus in Cahiers Evangile, N°160 (Juin 2012)
Au fil des rencontres in Cahiers Evangile, N°160 (Juin 2012)
" Entre exégètes et théologiens, la Bible..." / Élian Cuvillier in Cahiers Evangile, N°160 (Juin 2012)