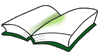[article]
| Titre : |
Une autre campagne Éditorial |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Revue Esprit, Auteur |
| Année de publication : |
2022 |
| Article en page(s) : |
5-6 |
| Langues : |
Français (fre) |
| Résumé : |
Alors que s’ouvre la campagne pour les présidentielles, et malgré le choc qu’a représenté la crise sanitaire, nombre de débats ont un goût de déjà-vu. On oppose à nouveau radicalité et responsabilité, alors que la responsabilité, en matière d’écologie notamment, appelle à une réforme radicale de nos modes de vie.
Par un hasard malencontreux du calendrier électoral, la France est en train de passer, sans transition ou presque, d’une crise sanitaire inédite à une saison d’élection présidentielle. Élection dont on sait le poids démesuré, dans la Ve République, sur la vie politique.
On aurait pu croire que la pandémie, en ébranlant toutes les dimensions de notre vie sociale, conduirait notre classe politique à reformuler en profondeur ses visions de l’avenir et ses priorités. Entre l’écologie, la santé, les inégalités sociales et le pacte entre les générations, en passant par l’avènement d’une société du tout numérique, les sujets qui appellent autant de nouveaux diagnostics que de nouvelles réponses ne manquent pas. En regard pourtant, voici que les candidats – déclarés ou présumés – nous parlent de « sécurité, première des libertés », de « souveraineté juridique retrouvée » en matière de frontières et de migrations, et de doublement du droit de vote pour les propriétaires de résidence secondaire aux municipales. Sans compter l’effet de parasitage, efficace puisque tous les médias en parlent, de polémiques aussi éphémères qu’indécentes, par exemple sur les prénoms des enfants français.
Les derniers dix-huit mois n’auraient-ils été qu’une parenthèse, à peine ouverte qu’aussitôt refermée ? Notre débat politique ressemble à ce personnage de Georges Simenon dans Les Anneaux de Bicêtre, le magnat de la presse René Maugras, qui se réveille paralysé sur un lit d’hôpital après un accident vasculaire cérébral. Entamant son examen de conscience, il se promet de changer radicalement son mode d’existence s’il en réchappe. Mais cette promesse s’émousse à mesure qu’il se rétablit, et les dernières pages du roman le voient reprendre sa vie d’avant. La reconduction du même est une tendance lourde, dans l’existence individuelle comme dans la vie collective. Nous aimons à nous croire capables de changement, à un horizon qui ne nous engage finalement pas. Et même quand se produit l’« accident », la prise de conscience qui en résulte échoue trop souvent à se traduire dans la réalité.
La campagne de la présidentielle à peine entamée, voici que l’on juge déjà trop « radicaux » celles et ceux dont les propositions en matière de transformation sociale, parce qu’elles bousculent les habitudes héritées, l’opinion publique ou les institutions, ne seraient pas crédibles. En face, la responsabilité reprend le visage familier du « réalisme », seul à même d’intégrer les paramètres sociaux, économiques ou politiques dans un programme raisonnable et rassembleur. Mais est-il bien responsable ou réaliste aujourd’hui de ne pas s’attaquer, radicalement, au désastre écologique, alors que les rapports du GIEC enchaînent les constats et les prévisions de plus en plus alarmistes ? Aux inégalités de richesses et de développement, quand les risques sanitaires et environnementaux sont si mal répartis ? Il existe bien en ce moment, à gauche comme à droite, une prime aux extrêmes : discours décomplexés et déclarations à l’emporte-pièce alimentent un courant continu de commentaires et de hashtags. Mais c’est de provocation, de démagogie ou de clientélisme électoral qu’il s’agit, plus que de radicalité. On peine pendant ce temps à voir émerger les débats qui interrogeront, à la racine, les causes de la crise dont nous ne sommes pas encore sortis : nos modes de production et de consommation, nos façons d’habiter, de travailler ou d’organiser la solidarité. On se désolera ensuite de constater que les citoyens, les jeunes en particulier, votent de moins en moins.
Il ne s’agit pas de croire ou de faire croire ici que les solutions aux défis qui sont devant nous seraient univoques, ni qu’elles seraient déjà sur la table, portées par un ou une candidate en particulier. Sur tous ces sujets, il existe des réponses politiques distinctes, que la délibération démocratique doit permettre de préciser, et entre lesquelles il faudra trancher. Nous sommes en droit en revanche d’exiger que soient posées aux électeurs les bonnes questions. À défaut d’un autre monde, une autre campagne électorale est possible.
|
| En ligne : |
https://esprit.presse.fr/article/esprit/une-autre-campagne-43571 |
in Esprit > N°478 (Revue Mensuel) . - 5-6
[article] Une autre campagne Éditorial [texte imprimé] / Revue Esprit, Auteur . - 2022 . - 5-6. Langues : Français ( fre) in Esprit > N°478 (Revue Mensuel) . - 5-6
| Résumé : |
Alors que s’ouvre la campagne pour les présidentielles, et malgré le choc qu’a représenté la crise sanitaire, nombre de débats ont un goût de déjà-vu. On oppose à nouveau radicalité et responsabilité, alors que la responsabilité, en matière d’écologie notamment, appelle à une réforme radicale de nos modes de vie.
Par un hasard malencontreux du calendrier électoral, la France est en train de passer, sans transition ou presque, d’une crise sanitaire inédite à une saison d’élection présidentielle. Élection dont on sait le poids démesuré, dans la Ve République, sur la vie politique.
On aurait pu croire que la pandémie, en ébranlant toutes les dimensions de notre vie sociale, conduirait notre classe politique à reformuler en profondeur ses visions de l’avenir et ses priorités. Entre l’écologie, la santé, les inégalités sociales et le pacte entre les générations, en passant par l’avènement d’une société du tout numérique, les sujets qui appellent autant de nouveaux diagnostics que de nouvelles réponses ne manquent pas. En regard pourtant, voici que les candidats – déclarés ou présumés – nous parlent de « sécurité, première des libertés », de « souveraineté juridique retrouvée » en matière de frontières et de migrations, et de doublement du droit de vote pour les propriétaires de résidence secondaire aux municipales. Sans compter l’effet de parasitage, efficace puisque tous les médias en parlent, de polémiques aussi éphémères qu’indécentes, par exemple sur les prénoms des enfants français.
Les derniers dix-huit mois n’auraient-ils été qu’une parenthèse, à peine ouverte qu’aussitôt refermée ? Notre débat politique ressemble à ce personnage de Georges Simenon dans Les Anneaux de Bicêtre, le magnat de la presse René Maugras, qui se réveille paralysé sur un lit d’hôpital après un accident vasculaire cérébral. Entamant son examen de conscience, il se promet de changer radicalement son mode d’existence s’il en réchappe. Mais cette promesse s’émousse à mesure qu’il se rétablit, et les dernières pages du roman le voient reprendre sa vie d’avant. La reconduction du même est une tendance lourde, dans l’existence individuelle comme dans la vie collective. Nous aimons à nous croire capables de changement, à un horizon qui ne nous engage finalement pas. Et même quand se produit l’« accident », la prise de conscience qui en résulte échoue trop souvent à se traduire dans la réalité.
La campagne de la présidentielle à peine entamée, voici que l’on juge déjà trop « radicaux » celles et ceux dont les propositions en matière de transformation sociale, parce qu’elles bousculent les habitudes héritées, l’opinion publique ou les institutions, ne seraient pas crédibles. En face, la responsabilité reprend le visage familier du « réalisme », seul à même d’intégrer les paramètres sociaux, économiques ou politiques dans un programme raisonnable et rassembleur. Mais est-il bien responsable ou réaliste aujourd’hui de ne pas s’attaquer, radicalement, au désastre écologique, alors que les rapports du GIEC enchaînent les constats et les prévisions de plus en plus alarmistes ? Aux inégalités de richesses et de développement, quand les risques sanitaires et environnementaux sont si mal répartis ? Il existe bien en ce moment, à gauche comme à droite, une prime aux extrêmes : discours décomplexés et déclarations à l’emporte-pièce alimentent un courant continu de commentaires et de hashtags. Mais c’est de provocation, de démagogie ou de clientélisme électoral qu’il s’agit, plus que de radicalité. On peine pendant ce temps à voir émerger les débats qui interrogeront, à la racine, les causes de la crise dont nous ne sommes pas encore sortis : nos modes de production et de consommation, nos façons d’habiter, de travailler ou d’organiser la solidarité. On se désolera ensuite de constater que les citoyens, les jeunes en particulier, votent de moins en moins.
Il ne s’agit pas de croire ou de faire croire ici que les solutions aux défis qui sont devant nous seraient univoques, ni qu’elles seraient déjà sur la table, portées par un ou une candidate en particulier. Sur tous ces sujets, il existe des réponses politiques distinctes, que la délibération démocratique doit permettre de préciser, et entre lesquelles il faudra trancher. Nous sommes en droit en revanche d’exiger que soient posées aux électeurs les bonnes questions. À défaut d’un autre monde, une autre campagne électorale est possible.
|
| En ligne : |
https://esprit.presse.fr/article/esprit/une-autre-campagne-43571 |
|  |


 Ajouter le résultat dans votre panier
Ajouter le résultat dans votre panierHidalgo et Pécresse : le temps des femmes en haut de la République / Michele Marian in Esprit, N°478 (Revue Mensuel)