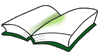| Titre : |
Halte à la mort des langues |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Claude Hagège (1936-....), Auteur |
| Editeur : |
Paris : Éditions Odile Jacob |
| Année de publication : |
2000 |
| Importance : |
1 vol. (402 p.) |
| Présentation : |
couv. ill. en coul. |
| Format : |
22 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7381-0897-5 |
| Langues : |
Français (fre) |
| Mots-clés : |
Langue Préservation de langue Langues menacées Politique linguistique sociolinguistique |
| Résumé : |
« Sait-on qu’en moyenne, il meurt environ 25 langues chaque année ? Dans cent ans, si rien ne change, la moitié de ces langues seront mortes. À la fin du XXIe siècle, il devrait donc en rester 2 500 environ, et sans doute beaucoup moins encore si l’on tient compte d’une accélération, fort possible, du rythme de disparition. Certes, comme les civilisations, les langues sont mortelles, et le gouffre de l’histoire est assez grand pour toutes. Pourtant, la mort des langues a quelque chose de tout à fait insolite, et d’exaltant quand nous nous en avisons : les langues sont capables de résurrection ! Mais la vigilance s’impose, faute de quoi toutes sont menacées, y compris le français. » C. H. |
| Note de contenu : |
Hagège appréhende les langues comme des « espèces naturelles vivantes » susceptibles de mourir et de ressusciter. La première partie traite du rapport réciproque nécessaire entre les langues et les communautés culturelles. Elle retrace l’inspiration vitaliste en linguistique, les perspectives évolutionniste et naturaliste, puis évalue à quel point les langues peuvent disparaître en s’appuyant sur la dichotomie « langue-parole ». La seconde partie cherche à définir ce qu’est une « langue morte ». Pour ce faire, l’auteur introduit le concept de langue « classique », observant le cas du latin et énumérant les langues disparues. S’ensuivent les trois visages de la disparition d’une langue – transformation, substitution et extinction –, puis l’inventaire des causes physiques, économiques, sociales et politiques de ces phénomènes, et enfin un bilan chiffré : la quantité de langues parlées, la distinction entre langue « en danger » et langue « menacée », de même qu’un portrait des disparitions in situ et en diaspora. La troisième partie montre que la résurrection d’une langue est possible, comme l’indique l’histoire de l’hébreu qui est devenu langue morte avant de réapparaître. La vitalité des créoles et le parcours du croate moderne attestent aussi que les langues ne sont pas dépourvues de ressorts. Pour finir, Hagège réfléchit sur l’anglo-américain véhiculaire (qui progresse au détriment de la diversité linguistique), l’engouement pour Internet et le statut actuel du français.Si certains mots peuvent mourir (p. 43), d’autres peuvent survivre en acquérant un nouveau sens, par le biais d’une substitution sémantique singulière ou plurielle. Le phénomène d’emprunt linguistique n’est pas une cause directe de l’extinction des langues, mais plutôt une étape significative de ce processus (p. 97) ; l’emprunt demeure un fait naturel pour toute langue vivante en constante évolution.La disparition des langues n’est pas un phénomène nouveau, mais les langues s’éteignent au rythme d’environ vingt-cinq par année, et le XXIe siècle voit la cadence s’accélérer. Malgré ces constats pessimistes, l’auteur ouvre la porte à la compréhension interne du processus, favorisant ainsi l’action concrète pour laquelle il propose plusieurs voies. Il faut donc recommander cette lecture à tous deux qui s’interrogent sur ce phénomène, qui n’est pas si irrépressible qu’on pourrait le craindre. |
Halte à la mort des langues [texte imprimé] / Claude Hagège (1936-....), Auteur . - Paris : Éditions Odile Jacob, 2000 . - 1 vol. (402 p.) : couv. ill. en coul. ; 22 cm. ISBN : 978-2-7381-0897-5 Langues : Français ( fre)
| Mots-clés : |
Langue Préservation de langue Langues menacées Politique linguistique sociolinguistique |
| Résumé : |
« Sait-on qu’en moyenne, il meurt environ 25 langues chaque année ? Dans cent ans, si rien ne change, la moitié de ces langues seront mortes. À la fin du XXIe siècle, il devrait donc en rester 2 500 environ, et sans doute beaucoup moins encore si l’on tient compte d’une accélération, fort possible, du rythme de disparition. Certes, comme les civilisations, les langues sont mortelles, et le gouffre de l’histoire est assez grand pour toutes. Pourtant, la mort des langues a quelque chose de tout à fait insolite, et d’exaltant quand nous nous en avisons : les langues sont capables de résurrection ! Mais la vigilance s’impose, faute de quoi toutes sont menacées, y compris le français. » C. H. |
| Note de contenu : |
Hagège appréhende les langues comme des « espèces naturelles vivantes » susceptibles de mourir et de ressusciter. La première partie traite du rapport réciproque nécessaire entre les langues et les communautés culturelles. Elle retrace l’inspiration vitaliste en linguistique, les perspectives évolutionniste et naturaliste, puis évalue à quel point les langues peuvent disparaître en s’appuyant sur la dichotomie « langue-parole ». La seconde partie cherche à définir ce qu’est une « langue morte ». Pour ce faire, l’auteur introduit le concept de langue « classique », observant le cas du latin et énumérant les langues disparues. S’ensuivent les trois visages de la disparition d’une langue – transformation, substitution et extinction –, puis l’inventaire des causes physiques, économiques, sociales et politiques de ces phénomènes, et enfin un bilan chiffré : la quantité de langues parlées, la distinction entre langue « en danger » et langue « menacée », de même qu’un portrait des disparitions in situ et en diaspora. La troisième partie montre que la résurrection d’une langue est possible, comme l’indique l’histoire de l’hébreu qui est devenu langue morte avant de réapparaître. La vitalité des créoles et le parcours du croate moderne attestent aussi que les langues ne sont pas dépourvues de ressorts. Pour finir, Hagège réfléchit sur l’anglo-américain véhiculaire (qui progresse au détriment de la diversité linguistique), l’engouement pour Internet et le statut actuel du français.Si certains mots peuvent mourir (p. 43), d’autres peuvent survivre en acquérant un nouveau sens, par le biais d’une substitution sémantique singulière ou plurielle. Le phénomène d’emprunt linguistique n’est pas une cause directe de l’extinction des langues, mais plutôt une étape significative de ce processus (p. 97) ; l’emprunt demeure un fait naturel pour toute langue vivante en constante évolution.La disparition des langues n’est pas un phénomène nouveau, mais les langues s’éteignent au rythme d’environ vingt-cinq par année, et le XXIe siècle voit la cadence s’accélérer. Malgré ces constats pessimistes, l’auteur ouvre la porte à la compréhension interne du processus, favorisant ainsi l’action concrète pour laquelle il propose plusieurs voies. Il faut donc recommander cette lecture à tous deux qui s’interrogent sur ce phénomène, qui n’est pas si irrépressible qu’on pourrait le craindre. |
|  |


 Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes
Ajouter le résultat dans votre panier Faire une suggestion Affiner la recherche Interroger des sources externes