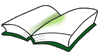|
|
[n° ou bulletin]
[n° ou bulletin]
N°3 - Avril 2023 - Entre agir et pâtir : Formes et sens du travail aujourd'hui [texte imprimé] . - 2024 . - 1 vol. (223 p) : couv. en coul. ; 24 cm. Langues : Français (fre)
|
Réservation
Réserver ce documentExemplaires(1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| OUV564210 | C18 AUB | Périodiques | Bibliothèque UCM | Sociologie du travail | Libre accès Disponible |
Dépouillements

 Ajouter le résultat dans votre panier
Ajouter le résultat dans votre panier
Titre : Introduction. Le travail : entre agir et pâtir Type de document : texte imprimé Auteurs : Emmanuel d' Hombres (1970-....), Auteur ; Ricardo Rezzesi, Auteur Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 11-26 Langues : Français (fre) Mots-clés : Travail Agir Pâtir Ambivalence Humanisme Résumé : Tout au long de l’histoire de la pensée, du fond de l’âge grec, depuis Hésiode et au-delà, comme dans la tradition biblique, nous retrouvons trace de l’ambivalence du travail, bipolarité inscrite au cœur même de l’expérience laborieuse. Le travail est une activité tantôt rangée du côté de l’action, voire de la création, dans ce que ces registres contiennent d’éminemment positif pour l’être humain, tantôt du côté de l’infortune et de la nécessité, nous rappelant à notre finitude ; tantôt considérée comme une punition, une calamité, un malheur, accidentel ou principiel, tantôt comme un moyen de salut, de libération, d’accès à la sphère éthique et à la reconnaissance, à la vie plénière de l’être. Par-delà leur diversité d’approche et de terrain, les études réunies dans ce numéro se retrouvent dans l’exigence d’honorer la bipolarité de l’agir et du pâtir qui caractérise la question (les questions) du travail. C’est à l’analyse de cette bipolarité, ou ambivalence, de l’expérience laborieuse que nous avons consacré cette introduction, en interrogeant, en même temps, la « place » (sens, valeur, réaffirmation ou perte de sa centralité) que le travail occupe dans nos sociétés. Note de contenu : Sommaire:
Généalogie d’un débat
Le travail et son ambivalence
Une centralité perdue ?
Quelques axes d’exploration
Contexte du projet
L’agir et le pâtir du /au travail à l’étude
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 11-26[article] Introduction. Le travail : entre agir et pâtir [texte imprimé] / Emmanuel d' Hombres (1970-....), Auteur ; Ricardo Rezzesi, Auteur . - 2024 . - p. 11-26.
Langues : Français (fre)
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 11-26
Mots-clés : Travail Agir Pâtir Ambivalence Humanisme Résumé : Tout au long de l’histoire de la pensée, du fond de l’âge grec, depuis Hésiode et au-delà, comme dans la tradition biblique, nous retrouvons trace de l’ambivalence du travail, bipolarité inscrite au cœur même de l’expérience laborieuse. Le travail est une activité tantôt rangée du côté de l’action, voire de la création, dans ce que ces registres contiennent d’éminemment positif pour l’être humain, tantôt du côté de l’infortune et de la nécessité, nous rappelant à notre finitude ; tantôt considérée comme une punition, une calamité, un malheur, accidentel ou principiel, tantôt comme un moyen de salut, de libération, d’accès à la sphère éthique et à la reconnaissance, à la vie plénière de l’être. Par-delà leur diversité d’approche et de terrain, les études réunies dans ce numéro se retrouvent dans l’exigence d’honorer la bipolarité de l’agir et du pâtir qui caractérise la question (les questions) du travail. C’est à l’analyse de cette bipolarité, ou ambivalence, de l’expérience laborieuse que nous avons consacré cette introduction, en interrogeant, en même temps, la « place » (sens, valeur, réaffirmation ou perte de sa centralité) que le travail occupe dans nos sociétés. Note de contenu : Sommaire:
Généalogie d’un débat
Le travail et son ambivalence
Une centralité perdue ?
Quelques axes d’exploration
Contexte du projet
L’agir et le pâtir du /au travail à l’étude
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité OUV564210 C18 AUB Périodiques Bibliothèque UCM Sociologie du travail Libre accès
DisponibleL’économie au risque du réalisme. Entretien avec Pierre-Yves Gomez / Pierre-Yves Gomez in Revue Confluence, N°3 (Avril 2023)
Titre : L’économie au risque du réalisme. Entretien avec Pierre-Yves Gomez Type de document : texte imprimé Auteurs : Pierre-Yves Gomez, Auteur ; Emmanuel d' Hombres (1970-....), Auteur ; Ricardo Rezzesi, Auteur Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 27-41 Langues : Français (fre) Mots-clés : Sens du travail Travail invisible Travail réel Capitalisme spéculatif Économie financiarisée Nouvel humanisme Résumé : Alors que l’économie tient une place centrale dans nos représentations du « vivre ensemble », comment comprendre l’invisibilisation inexorable du travail réel, pourtant au cœur de l’économie matérielle ? Articulant un humanisme « réaliste » avec une rare rigueur analytique et un sens aigu de la narration, Pierre-Yves Gomez, économiste en quête d’interdisciplinarité et grand spécialiste du travail et de l’entreprise, nous aide dans cet entretien à décrypter les récits anthropologiques qui circulent aujourd’hui sur l’économie (de l’utilitarisme néolibéral au transhumanisme). Il nous livre quelques-uns des points d’ancrages de sa vaste réflexion économique : 1) son approche « évolutionniste » dans l’analyse historique des faits socioéconomiques ; 2) les sources et modèles qui ont contribué à la formation de son regard interdisciplinaire ; 3) un sens de la complexité du monde capable d’embrasser les interactions entre croyances, culture(s) et infrastructures économiques ; 4) le souci, enfin, de promouvoir une nouveau regard sur l’économie à partir de l’apport d’autres démarches intellectuelles : de la philosophie à la littérature. Un beau programme pour une belle rencontre. Note de contenu :
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 27-41[article] L’économie au risque du réalisme. Entretien avec Pierre-Yves Gomez [texte imprimé] / Pierre-Yves Gomez, Auteur ; Emmanuel d' Hombres (1970-....), Auteur ; Ricardo Rezzesi, Auteur . - 2024 . - p. 27-41.
Langues : Français (fre)
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 27-41
Mots-clés : Sens du travail Travail invisible Travail réel Capitalisme spéculatif Économie financiarisée Nouvel humanisme Résumé : Alors que l’économie tient une place centrale dans nos représentations du « vivre ensemble », comment comprendre l’invisibilisation inexorable du travail réel, pourtant au cœur de l’économie matérielle ? Articulant un humanisme « réaliste » avec une rare rigueur analytique et un sens aigu de la narration, Pierre-Yves Gomez, économiste en quête d’interdisciplinarité et grand spécialiste du travail et de l’entreprise, nous aide dans cet entretien à décrypter les récits anthropologiques qui circulent aujourd’hui sur l’économie (de l’utilitarisme néolibéral au transhumanisme). Il nous livre quelques-uns des points d’ancrages de sa vaste réflexion économique : 1) son approche « évolutionniste » dans l’analyse historique des faits socioéconomiques ; 2) les sources et modèles qui ont contribué à la formation de son regard interdisciplinaire ; 3) un sens de la complexité du monde capable d’embrasser les interactions entre croyances, culture(s) et infrastructures économiques ; 4) le souci, enfin, de promouvoir une nouveau regard sur l’économie à partir de l’apport d’autres démarches intellectuelles : de la philosophie à la littérature. Un beau programme pour une belle rencontre. Note de contenu :
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité OUV564210 C18 AUB Périodiques Bibliothèque UCM Sociologie du travail Libre accès
DisponibleLe travail, une épreuve au service de la communion fraternelle, selon Jean Calvin in Revue Confluence, N°3 (Avril 2023)
Titre : Le travail, une épreuve au service de la communion fraternelle, selon Jean Calvin Type de document : texte imprimé Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 43-61 Langues : Français (fre) Mots-clés : Théologie protestante Travail Sanctification Jean Calvin Éthique Résumé : « Car tous ceux que le Seigneur a adoptés et reçus en la compagnie de ses enfants, se doivent préparer à une vie dure, laborieuse, pleine de travail et d’infinis genres de maux », écrit le réformateur Jean Calvin (1509-1564) dans l’Institution de la Religion Chrétienne. Or le travail est aussi une nécessité de nature, dira-t-il par ailleurs, mais que le chrétien est appelé à transformer en possibilité de témoigner de la gloire de Dieu. En ce double sens, le travail est une épreuve dont Calvin va enrichir le sens très au-delà de la seule pénibilité des tâches. Dans cette compréhension, la vie entière se trouve engagée dans un processus de conversion qui concourt à rendre compte de la puissance créatrice d’un Dieu provident qui fournit à chacun les biens et les capacités selon ses besoins. Surmonter l’épreuve consiste à accepter une transformation de soi en vue de transformer la société en une communion fraternelle. Cette contribution cherche à éclairer la part calvinienne de ce que Max Weber a qualifié, parlant d’un protestantisme plus tardif, d’ascétisme intramondain. Mais en replaçant cette épreuve qu’est le travail dans la visée d’une société solidaire et reconnaissante, elle ouvre peut-être aussi des possibilités de sens pour une compréhension renouvelée du travail aujourd’hui. Note de contenu : Sommaire:
Le travail, une triple épreuve de conversion
Reconnaître Dieu auteur de tout bien
Servir le prochain
La restauration de l’image de Dieu en l’humain
Travail et sanctification du chrétien
Retrouver le sens de l’abondance perdue
Ordonner sa vie jusque dans tous ses actes
Convertir les cœurs au Christ
Ce n’est qu’à partir de ce préalable que le juste usage des biens peut être envisagé
L’horizon du don pour une éthique du travail
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 43-61[article] Le travail, une épreuve au service de la communion fraternelle, selon Jean Calvin [texte imprimé] . - 2024 . - p. 43-61.
Langues : Français (fre)
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 43-61
Mots-clés : Théologie protestante Travail Sanctification Jean Calvin Éthique Résumé : « Car tous ceux que le Seigneur a adoptés et reçus en la compagnie de ses enfants, se doivent préparer à une vie dure, laborieuse, pleine de travail et d’infinis genres de maux », écrit le réformateur Jean Calvin (1509-1564) dans l’Institution de la Religion Chrétienne. Or le travail est aussi une nécessité de nature, dira-t-il par ailleurs, mais que le chrétien est appelé à transformer en possibilité de témoigner de la gloire de Dieu. En ce double sens, le travail est une épreuve dont Calvin va enrichir le sens très au-delà de la seule pénibilité des tâches. Dans cette compréhension, la vie entière se trouve engagée dans un processus de conversion qui concourt à rendre compte de la puissance créatrice d’un Dieu provident qui fournit à chacun les biens et les capacités selon ses besoins. Surmonter l’épreuve consiste à accepter une transformation de soi en vue de transformer la société en une communion fraternelle. Cette contribution cherche à éclairer la part calvinienne de ce que Max Weber a qualifié, parlant d’un protestantisme plus tardif, d’ascétisme intramondain. Mais en replaçant cette épreuve qu’est le travail dans la visée d’une société solidaire et reconnaissante, elle ouvre peut-être aussi des possibilités de sens pour une compréhension renouvelée du travail aujourd’hui. Note de contenu : Sommaire:
Le travail, une triple épreuve de conversion
Reconnaître Dieu auteur de tout bien
Servir le prochain
La restauration de l’image de Dieu en l’humain
Travail et sanctification du chrétien
Retrouver le sens de l’abondance perdue
Ordonner sa vie jusque dans tous ses actes
Convertir les cœurs au Christ
Ce n’est qu’à partir de ce préalable que le juste usage des biens peut être envisagé
L’horizon du don pour une éthique du travail
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité OUV564210 C18 AUB Périodiques Bibliothèque UCM Sociologie du travail Libre accès
DisponibleEntre aliénation et alliance entre les hommes / Emmanuel Gabellieri in Revue Confluence, N°3 (Avril 2023)
Titre : Entre aliénation et alliance entre les hommes : le travail, "philosophie première"? Type de document : texte imprimé Auteurs : Emmanuel Gabellieri (1957-....), Auteur Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 63-76 Langues : Français (fre) Mots-clés : Travail, Philosophie première Anthropologie du don Coopération Alliance Entrepreneuriat social Résumé : Des Grecs à H. Arendt, le travail est vu comme une soumission aliénante à la nécessité, naturelle ou sociale. Mais ce n’est vrai, pour S. Weil, que si le travail, paradoxalement, est nié dans sa vérité, laquelle consiste en un acte de révélation de la réalité du monde, du pouvoir créateur du sujet, et de la coopération entre les hommes. Interdisant de le réduire à un ensemble de moyens opposés aux fins, ceci permet alors d’intégrer le travail à ce que les Anciens nommaient la « philosophie première ». De l’anthropologie du don aux « critical studies » en management, cette perspective rejoint bien des dimensions de la réflexion contemporaine en ergonomie, économie et sciences sociales. Sortant des oppositions entre « privé » et « public » ou « travail » et « action », elle rend attentif aux multiples actions et stratégies actuelles de co-construction du bien commun reposant souvent sur les partenariats entre les entreprises et leurs territoires. Note de contenu : Sommaire:
« Philosophie première » ?
Le travail comme coopération et alliance entre les hommes
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 63-76[article] Entre aliénation et alliance entre les hommes : le travail, "philosophie première"? [texte imprimé] / Emmanuel Gabellieri (1957-....), Auteur . - 2024 . - p. 63-76.
Langues : Français (fre)
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 63-76
Mots-clés : Travail, Philosophie première Anthropologie du don Coopération Alliance Entrepreneuriat social Résumé : Des Grecs à H. Arendt, le travail est vu comme une soumission aliénante à la nécessité, naturelle ou sociale. Mais ce n’est vrai, pour S. Weil, que si le travail, paradoxalement, est nié dans sa vérité, laquelle consiste en un acte de révélation de la réalité du monde, du pouvoir créateur du sujet, et de la coopération entre les hommes. Interdisant de le réduire à un ensemble de moyens opposés aux fins, ceci permet alors d’intégrer le travail à ce que les Anciens nommaient la « philosophie première ». De l’anthropologie du don aux « critical studies » en management, cette perspective rejoint bien des dimensions de la réflexion contemporaine en ergonomie, économie et sciences sociales. Sortant des oppositions entre « privé » et « public » ou « travail » et « action », elle rend attentif aux multiples actions et stratégies actuelles de co-construction du bien commun reposant souvent sur les partenariats entre les entreprises et leurs territoires. Note de contenu : Sommaire:
« Philosophie première » ?
Le travail comme coopération et alliance entre les hommesRéservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité OUV564210 C18 AUB Périodiques Bibliothèque UCM Sociologie du travail Libre accès
DisponibleLe travail comme communion in Revue Confluence, N°3 (Avril 2023)
Titre : Le travail comme communion : management et entreprise à orientation sociale Type de document : texte imprimé Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 77-92 Langues : Français (fre) Mots-clés : Responsabilité sociale de l'entreprise Orientation sociale de l'entreprise Communion Connaissance Relations Résumé : Le phénomène de la responsabilité sociale des entreprises, dans un contexte de plus en plus caractérisé par la primauté du facteur connaissance, amène à attribuer une importance croissante aux entreprises à vocation sociale. La place, ou plutôt la centralité, attribuée à la personne et à la qualité des relations qui sont mises en jeu au sein de l’entreprise et dans les relations qu’elle tisse avec le contexte environnemental dans une perspective socialement responsable, définit ce qui qualifie fondamentalement l’orientation sociale de l’entreprise. Dans cette contribution, nous nous interrogeons sur la manière dont, dans de telles entreprises, il est possible de concevoir, dans une perspective managériale, le travail comme communion. Note de contenu : Sommaire:
Évolution historique des orientations
Primat du facteur connaissance et changement dans les relations entreprise-société
Perspectives pour un travail vécu « en communion »
Conclusion
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 77-92[article] Le travail comme communion : management et entreprise à orientation sociale [texte imprimé] . - 2024 . - p. 77-92.
Langues : Français (fre)
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 77-92
Mots-clés : Responsabilité sociale de l'entreprise Orientation sociale de l'entreprise Communion Connaissance Relations Résumé : Le phénomène de la responsabilité sociale des entreprises, dans un contexte de plus en plus caractérisé par la primauté du facteur connaissance, amène à attribuer une importance croissante aux entreprises à vocation sociale. La place, ou plutôt la centralité, attribuée à la personne et à la qualité des relations qui sont mises en jeu au sein de l’entreprise et dans les relations qu’elle tisse avec le contexte environnemental dans une perspective socialement responsable, définit ce qui qualifie fondamentalement l’orientation sociale de l’entreprise. Dans cette contribution, nous nous interrogeons sur la manière dont, dans de telles entreprises, il est possible de concevoir, dans une perspective managériale, le travail comme communion. Note de contenu : Sommaire:
Évolution historique des orientations
Primat du facteur connaissance et changement dans les relations entreprise-société
Perspectives pour un travail vécu « en communion »
Conclusion
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité OUV564210 C18 AUB Périodiques Bibliothèque UCM Sociologie du travail Libre accès
DisponibleQue convient-il de faire ? Notes de réflexion entre éthique et économie in Revue Confluence, N°3 (Avril 2023)
Titre : Que convient-il de faire ? Notes de réflexion entre éthique et économie Type de document : texte imprimé Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 93-103 Langues : Français (fre) Mots-clés : Personne Philosophie du travail Économie civile Simone Weil Humanisme de l'"entre" Adriano Olive Résumé : Ces notes proposent une lecture « critique » des mutations économiques actuelles afin de promouvoir une culture de l'innovation œuvrant à l’épanouissement de la personne dans toutes ses dimensions. L’auteur défend une vision relationnelle et sociale de l’économie, à l’encontre de sa réduction moderne à une science de l’égoïsme ou de l’isolement, signe d’une séparation entre économie, éthique et politique. Dans cette perspective, il promeut un renouvellement du savoir économique à partir du dialogue avec la philosophie, nous invitant à sonder tant la conception weilienne du progrès que la dynamique de réciprocité authentique défendue par l’économie civile italienne. Dans le sillage d’Adriano Olivetti, l’auteur inscrit ainsi ses réflexions au cœur d’un humanisme de l’« entre », une ontologie de la relation qui dépasse tout dualisme, soulignant la non-opposition, voire l’interaction entre travail, liberté et épanouissement personnel.
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 93-103[article] Que convient-il de faire ? Notes de réflexion entre éthique et économie [texte imprimé] . - 2024 . - p. 93-103.
Langues : Français (fre)
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 93-103
Mots-clés : Personne Philosophie du travail Économie civile Simone Weil Humanisme de l'"entre" Adriano Olive Résumé : Ces notes proposent une lecture « critique » des mutations économiques actuelles afin de promouvoir une culture de l'innovation œuvrant à l’épanouissement de la personne dans toutes ses dimensions. L’auteur défend une vision relationnelle et sociale de l’économie, à l’encontre de sa réduction moderne à une science de l’égoïsme ou de l’isolement, signe d’une séparation entre économie, éthique et politique. Dans cette perspective, il promeut un renouvellement du savoir économique à partir du dialogue avec la philosophie, nous invitant à sonder tant la conception weilienne du progrès que la dynamique de réciprocité authentique défendue par l’économie civile italienne. Dans le sillage d’Adriano Olivetti, l’auteur inscrit ainsi ses réflexions au cœur d’un humanisme de l’« entre », une ontologie de la relation qui dépasse tout dualisme, soulignant la non-opposition, voire l’interaction entre travail, liberté et épanouissement personnel. Réservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité OUV564210 C18 AUB Périodiques Bibliothèque UCM Sociologie du travail Libre accès
DisponibleCulture et civilisation comme réponse à la crise du sens du travail in Revue Confluence, N°3 (Avril 2023)
Titre : Culture et civilisation comme réponse à la crise du sens du travail : de l’humanisme d’Adriano Olivetti à sa postérité Type de document : texte imprimé Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 105-117 Langues : Français (fre) Mots-clés : Adriano Olivetti Travail Interventions artistiques Éthique Résumé : Cette contribution invite à considérer la culture et la civilisation comme réponse à la crise contemporaine du sens du travail, en attirant l’attention sur certaines expériences entrepreneuriales actuelles. À partir de l’analyse de l’humanisme d’Adriano Olivetti, en tant qu’exemple d’interaction profonde entre le travail, la culture et la civilisation, nous essayons d’y souligner l’anticipation de certaines questions importantes relatives au rapport entre éthique et entreprise aujourd’hui. Puis l’analyse se concentre sur la relation entre le monde de l’art et celui de l’entreprise, en particulier sur les interventions artistiques dans l’entreprise, afin de valoriser l’impact éthique possible, en avançant l’hypothèse d’une « possible postérité » de l’expérience entrepreneuriale mise en œuvre par Adriano Olivetti. Note de contenu : Sommaire:
L’humanisme d’Olivetti
Une possible postérité : les interactions entre art et entreprise
Conclusion : l’humanité dans le travail
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 105-117[article] Culture et civilisation comme réponse à la crise du sens du travail : de l’humanisme d’Adriano Olivetti à sa postérité [texte imprimé] . - 2024 . - p. 105-117.
Langues : Français (fre)
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 105-117
Mots-clés : Adriano Olivetti Travail Interventions artistiques Éthique Résumé : Cette contribution invite à considérer la culture et la civilisation comme réponse à la crise contemporaine du sens du travail, en attirant l’attention sur certaines expériences entrepreneuriales actuelles. À partir de l’analyse de l’humanisme d’Adriano Olivetti, en tant qu’exemple d’interaction profonde entre le travail, la culture et la civilisation, nous essayons d’y souligner l’anticipation de certaines questions importantes relatives au rapport entre éthique et entreprise aujourd’hui. Puis l’analyse se concentre sur la relation entre le monde de l’art et celui de l’entreprise, en particulier sur les interventions artistiques dans l’entreprise, afin de valoriser l’impact éthique possible, en avançant l’hypothèse d’une « possible postérité » de l’expérience entrepreneuriale mise en œuvre par Adriano Olivetti. Note de contenu : Sommaire:
L’humanisme d’Olivetti
Une possible postérité : les interactions entre art et entreprise
Conclusion : l’humanité dans le travailRéservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité OUV564210 C18 AUB Périodiques Bibliothèque UCM Sociologie du travail Libre accès
DisponibleDroit au travail in Revue Confluence, N°3 (Avril 2023)
Titre : Droit au travail : Liberté fondamentale d’agir en conditions décentes pour s’émanciper du risque pâtissant Type de document : texte imprimé Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 119-138 Langues : Français (fre) Mots-clés : Liberté Droit au travail Droit du travail Risque pâtissant Émancipation Résumé : Le droit au travail, liberté fondamentale et faculté de s’engager dans un contrat de travail encastrant les relations socioéconomiques entre travailleurs dans des conditions respectueuses de la dignité humaine, devrait être vecteur d’émancipation individuelle et sociale de la personne du travailleur, évitant le risque pâtissant. L’État moderne, partie prenante du rapport de force entre le groupe patronal et le groupe syndical, définit le droit du travail comme un espace commun de conciliation dynamique entre la liberté d’entreprendre et le droit à des conditions dignes de travail. Toutefois, le droit fondamental à un emploi, voie royale du « travailler » et de la réalisation de sa vie, semble consacré dans une vision réductrice de « devoir-droit » de travailler qu’il convient de dépasser pour l’émancipation individuelle et sociale. Selon les indicateurs de la Charte internationale des droits de l’Homme et des Normes internationales du travail, le premier principe juridique fondamental pour éviter le risque pâtissant du travail, est la liberté de choisir son travail dans un large spectre sociétal d’activités plurielles, reconnues, promues et protégées. Le second principe juridique fondamental qui permet de juguler le risque de pâtir du travail est de travailler dans des conditions humaines, « dignes », « décentes », « justes et favorables ». Note de contenu : Sommaire:
Le droit au travail, droit au libre choix du travail : précondition prévenant le risque pâtissant
Le droit à un emploi, un droit du travail institué comme cadre d’agir non pâtissant ?
Le droit au travail, une liberté socioéconomique d’agir
Le droit à des conditions justes et favorables pour éviter un sinistre pâtissant au travail
Conditions matérielles de durée, sécurité et rémunération du travail
La démocratie au travail : liberté de participation sociale et syndicale, dialogue social et solidarité
Conclusion
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 119-138[article] Droit au travail : Liberté fondamentale d’agir en conditions décentes pour s’émanciper du risque pâtissant [texte imprimé] . - 2024 . - p. 119-138.
Langues : Français (fre)
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 119-138
Mots-clés : Liberté Droit au travail Droit du travail Risque pâtissant Émancipation Résumé : Le droit au travail, liberté fondamentale et faculté de s’engager dans un contrat de travail encastrant les relations socioéconomiques entre travailleurs dans des conditions respectueuses de la dignité humaine, devrait être vecteur d’émancipation individuelle et sociale de la personne du travailleur, évitant le risque pâtissant. L’État moderne, partie prenante du rapport de force entre le groupe patronal et le groupe syndical, définit le droit du travail comme un espace commun de conciliation dynamique entre la liberté d’entreprendre et le droit à des conditions dignes de travail. Toutefois, le droit fondamental à un emploi, voie royale du « travailler » et de la réalisation de sa vie, semble consacré dans une vision réductrice de « devoir-droit » de travailler qu’il convient de dépasser pour l’émancipation individuelle et sociale. Selon les indicateurs de la Charte internationale des droits de l’Homme et des Normes internationales du travail, le premier principe juridique fondamental pour éviter le risque pâtissant du travail, est la liberté de choisir son travail dans un large spectre sociétal d’activités plurielles, reconnues, promues et protégées. Le second principe juridique fondamental qui permet de juguler le risque de pâtir du travail est de travailler dans des conditions humaines, « dignes », « décentes », « justes et favorables ». Note de contenu : Sommaire:
Le droit au travail, droit au libre choix du travail : précondition prévenant le risque pâtissant
Le droit à un emploi, un droit du travail institué comme cadre d’agir non pâtissant ?
Le droit au travail, une liberté socioéconomique d’agir
Le droit à des conditions justes et favorables pour éviter un sinistre pâtissant au travail
Conditions matérielles de durée, sécurité et rémunération du travail
La démocratie au travail : liberté de participation sociale et syndicale, dialogue social et solidarité
ConclusionRéservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité OUV564210 C18 AUB Périodiques Bibliothèque UCM Sociologie du travail Libre accès
DisponibleQuand travailler rend éco-anxieux in Revue Confluence, N°3 (Avril 2023)
Titre : Quand travailler rend éco-anxieux Type de document : texte imprimé Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 139-164 Langues : Français (fre) Résumé : Les entreprises, en grande partie responsables du dérèglement climatique du fait de leurs activités thermo-industrielles et de leurs externalités négatives, provoquent un refus d’agir voire du pâtir pour certains de leurs salariés, jusqu’à les rendre éco-anxieux. À quoi bon travailler pour un employeur qui pollue la planète et détruit le vivant ? L’éco-anxiété n’est ni une maladie ni une malédiction. Elle se dépasse par l’action, dès lors que l’éco-anxieux passe d’une peur qui l’immobilise à une peur qui le mobilise, grâce à un travail sur soi adéquat. Pour ce faire, il convient au préalable de diagnostiquer l’éco-anxiété avec un outillage ad hoc. C’est ce que propose la version française validée de l’échelle d’éco-anxiété de Hogg (EEAH). Une comparaison des scores à l’EEAH d’un échantillon de 1600 répondants avec 27 éco-anxieux en psychothérapie montre les caractéristiques de l’éco-anxiété en France, et bouscule l’idée reçue que les jeunes seraient majoritairement éco-anxieux. Note de contenu : Sommaire:
L’éco-anxiété n’est pas une maladie, mais peut rendre malade
Éco-anxiété : clarifications conceptuelles
Présentation de l’échelle d’éco-anxiété de Hogg (EEAH-13)
Méthodologie
Design de recherche
Participants
Mesures et résultats
Approche macro
Statistiques générales
Analyse du lien âge/éco-anxiété et des liens sexe et niveau d’étude/éco-anxiété
Analyse par facteur
Approche micro
Discussion des résultats
Conclusion
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 139-164[article] Quand travailler rend éco-anxieux [texte imprimé] . - 2024 . - p. 139-164.
Langues : Français (fre)
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 139-164
Résumé : Les entreprises, en grande partie responsables du dérèglement climatique du fait de leurs activités thermo-industrielles et de leurs externalités négatives, provoquent un refus d’agir voire du pâtir pour certains de leurs salariés, jusqu’à les rendre éco-anxieux. À quoi bon travailler pour un employeur qui pollue la planète et détruit le vivant ? L’éco-anxiété n’est ni une maladie ni une malédiction. Elle se dépasse par l’action, dès lors que l’éco-anxieux passe d’une peur qui l’immobilise à une peur qui le mobilise, grâce à un travail sur soi adéquat. Pour ce faire, il convient au préalable de diagnostiquer l’éco-anxiété avec un outillage ad hoc. C’est ce que propose la version française validée de l’échelle d’éco-anxiété de Hogg (EEAH). Une comparaison des scores à l’EEAH d’un échantillon de 1600 répondants avec 27 éco-anxieux en psychothérapie montre les caractéristiques de l’éco-anxiété en France, et bouscule l’idée reçue que les jeunes seraient majoritairement éco-anxieux. Note de contenu : Sommaire:
L’éco-anxiété n’est pas une maladie, mais peut rendre malade
Éco-anxiété : clarifications conceptuelles
Présentation de l’échelle d’éco-anxiété de Hogg (EEAH-13)
Méthodologie
Design de recherche
Participants
Mesures et résultats
Approche macro
Statistiques générales
Analyse du lien âge/éco-anxiété et des liens sexe et niveau d’étude/éco-anxiété
Analyse par facteur
Approche micro
Discussion des résultats
ConclusionRéservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité OUV564210 C18 AUB Périodiques Bibliothèque UCM Sociologie du travail Libre accès
DisponibleThe Regulation of Plurality in Mauritian Hinduism in Revue Confluence, N°3 (Avril 2023)
Titre : The Regulation of Plurality in Mauritian Hinduism : History, actors, and practices Type de document : texte imprimé Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 169-190 Langues : Français (fre) Mots-clés : Maurice Hindouisme Plantation Pluralité Créolité Résumé : La pluralité de la jeune nation mauricienne n’est pas seulement inscrite dans l’histoire, elle est fondatrice et structurante, ancrée dans la violence radicale de la colonisation, de l’esclavage et de la plantation. J’étudie les dynamiques croisées de la régulation de la pluralité dans la société mauricienne et de la redéfinition de l’hindouisme, de ses frontières internes et externes, à partir de l’histoire et de l’ethnographie des lieux de culte, des pratiques et des acteurs qui la construisent. J’envisage chronologiquement les différentes phases de l’exportation de l’hindouisme et de sa pluralité à Maurice : quelles sont les conséquences lorsque les engagés quittent le territoire indien, lorsqu’ils partagent la traversée de l’océan en bateau, lorsqu’ils s’installent dans la plantation plurielle et lorsqu’ils s’inscrivent dans un État indépendant et séculier ? Note de contenu : Sommaire:
The effects of indenture on Hinduism
Indian Hinduism in the 19th century
Hinduism during the time of indenture
The effects of the plantation on Hinduism
The effects of the Mauritian State on Hinduism
Conclusion
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 169-190[article] The Regulation of Plurality in Mauritian Hinduism : History, actors, and practices [texte imprimé] . - 2024 . - p. 169-190.
Langues : Français (fre)
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 169-190
Mots-clés : Maurice Hindouisme Plantation Pluralité Créolité Résumé : La pluralité de la jeune nation mauricienne n’est pas seulement inscrite dans l’histoire, elle est fondatrice et structurante, ancrée dans la violence radicale de la colonisation, de l’esclavage et de la plantation. J’étudie les dynamiques croisées de la régulation de la pluralité dans la société mauricienne et de la redéfinition de l’hindouisme, de ses frontières internes et externes, à partir de l’histoire et de l’ethnographie des lieux de culte, des pratiques et des acteurs qui la construisent. J’envisage chronologiquement les différentes phases de l’exportation de l’hindouisme et de sa pluralité à Maurice : quelles sont les conséquences lorsque les engagés quittent le territoire indien, lorsqu’ils partagent la traversée de l’océan en bateau, lorsqu’ils s’installent dans la plantation plurielle et lorsqu’ils s’inscrivent dans un État indépendant et séculier ? Note de contenu : Sommaire:
The effects of indenture on Hinduism
Indian Hinduism in the 19th century
Hinduism during the time of indenture
The effects of the plantation on Hinduism
The effects of the Mauritian State on Hinduism
ConclusionRéservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité OUV564210 C18 AUB Périodiques Bibliothèque UCM Sociologie du travail Libre accès
DisponibleLe théologico-politique. Genèse et constitution d’un problème / Emilie Tardivel in Revue Confluence, N°3 (Avril 2023)
Titre : Le théologico-politique. Genèse et constitution d’un problème Type de document : texte imprimé Auteurs : Emilie Tardivel, Auteur Année de publication : 2024 Article en page(s) : p. 191-206 Langues : Français (fre) Mots-clés : Théologie politique Bien commun Libéralisme Carl Schmitt Hobbes Spinoza Résumé : Bien que le Traité théologico-politique soit à l’origine de la réactivation du « problème théologico-politique » au XXe siècle (de Leo Strauss à Carl Schmitt), Spinoza n’invente pas ce problème ni ne l’introduit dans la philosophie politique moderne. Spinoza hérite de ce problème non seulement des théologiens réformés du début du XVIIe siècle, mais également de l’interprétation qu’en propose Hobbes dans le Léviathan. Le but de cet article est de reconstruire ce double héritage et de montrer que l’originalité du Traité théologico-politique consiste à achever la constitution philosophique du « problème théologico-politique », et à faire porter la charge de ce problème au concept de bien commun. C’est cette charge qui caractérise originellement la conception libérale du bien commun et explique ses paradoxes. Note de contenu : Sommaire:
La genèse théologique d’un problème
La constitution philosophique d’un problème
Conclusion
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 191-206[article] Le théologico-politique. Genèse et constitution d’un problème [texte imprimé] / Emilie Tardivel, Auteur . - 2024 . - p. 191-206.
Langues : Français (fre)
in Revue Confluence > N°3 (Avril 2023) . - p. 191-206
Mots-clés : Théologie politique Bien commun Libéralisme Carl Schmitt Hobbes Spinoza Résumé : Bien que le Traité théologico-politique soit à l’origine de la réactivation du « problème théologico-politique » au XXe siècle (de Leo Strauss à Carl Schmitt), Spinoza n’invente pas ce problème ni ne l’introduit dans la philosophie politique moderne. Spinoza hérite de ce problème non seulement des théologiens réformés du début du XVIIe siècle, mais également de l’interprétation qu’en propose Hobbes dans le Léviathan. Le but de cet article est de reconstruire ce double héritage et de montrer que l’originalité du Traité théologico-politique consiste à achever la constitution philosophique du « problème théologico-politique », et à faire porter la charge de ce problème au concept de bien commun. C’est cette charge qui caractérise originellement la conception libérale du bien commun et explique ses paradoxes. Note de contenu : Sommaire:
La genèse théologique d’un problème
La constitution philosophique d’un problème
ConclusionRéservation
Réserver ce document
Exemplaires(1)
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité OUV564210 C18 AUB Périodiques Bibliothèque UCM Sociologie du travail Libre accès
Disponible